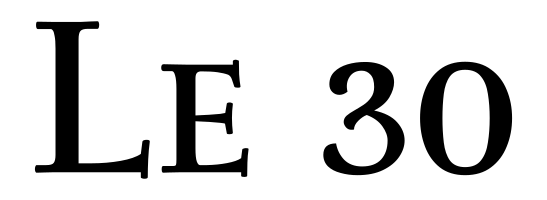Un collectif citoyen s’est emparé de la mairie de Poitiers en 2020. Cette manœuvre a en réalité été l’occasion pour les Écologistes de placer l’une des leurs à la tête de la préfecture de la Vienne et de recycler une conseillère régionale à un autre poste. La promesse d’une liste citoyenne plus représentative et plus proche des habitant·es de la ville ne tient pas. Décryptage.
Un Collectif Citoyen ? Les promesses de Poitiers Collectif
Poitiers Collectif s’était engagé à faire de la politique autrement, porté par une dynamique citoyenne et accompagné par la coopérative Fréquence Commune, une coopérative spécialisée dans l’appui aux listes citoyennes. Avec cette alliance, la promesse était claire : rompre avec les pratiques politiques traditionnelles, insuffler un vent de nouveauté et donner un réel pouvoir d’action aux habitant·es. Pourtant, une analyse sociologique de la majorité municipale révèle une autre réalité.
Malgré ses aspirations progressistes, la liste Poitiers Collectif semble perpétuer des dynamiques politiques classiques. Sociologiquement, les cadres dominent largement le conseil municipal. Cette contradiction entre promesses de rupture et réalité de gouvernance met en doute la capacité de ces listes dites « citoyennes » à renouveler véritablement les pratiques démocratiques.
Une majorité de cadres : un reflet biaisé de la population
Nous avons étudié les profils socioprofessionnels des 38 élu·es de Poitiers Collectif, en utilisant les catégories de l’INSEE pour mesurer leur représentativité. Nous avons attribué aux retraités la catégorie professionnelle qu’ils et elles occupaient avant leur départ et aux personnes sans emploi leur dernier poste connu. Les résultats sont frappants.
61 % des élu·es sont des cadres ou des membres des professions intellectuelles supérieures, soit presque trois fois la moyenne nationale (22 %) et locale (également 22 %). La plupart proviennent de la fonction publique, un vivier traditionnel des élites politiques. Autre surreprésentation notable : les chefs d’entreprise, artisans et commerçants représentent 13 % des élu·es, contre 4 % à Poitiers !
À l’inverse, les employé·es et ouvrier·es, qui constituent 48 % de la population pictavienne, sont quasi absents et absentes du conseil municipal. Une seule personne parmi les élu·es appartient à cette catégorie. Dans une ville où ces groupes représentent près de la moitié des habitants, le conseil municipal devrait compter environ 12 employé·es et 6 ouvrier·es.
Ces chiffres révèlent un déséquilibre criant. Les catégories populaires, pourtant les plus concernées par les politiques municipales, sont largement sous-représentées. Ce constat n’est pas isolé : il reflète une tendance nationale où les élus locaux proviennent majoritairement des classes supérieures, souvent en raison de contraintes structurelles et d’un système électoral qui favorise les plus dotés en capital culturel et social.
Un problème structurel : la production des élites politiques
Au-delà des statistiques, un cas emblématique illustre cette situation : celui de la mairesse. Ses seuls emplois connus avant son élection sont : secrétaire de campagne, élue régionale, puis mairesse de Poitiers. Diplômée de Sciences Po, membre d’un parti politique, elle incarne un parcours typique d’une production des petites élites politiques françaises.
C’est un archétype banal d’un ancien monde politique, celui-là même que Poitiers Collectif prétendait dépasser, et contredit à elle seule les aspirations initiales du collectif. Loin de rompre avec les dynamiques de professionnalisation politique, cette trajectoire perpétue un modèle où les élu·es sont issu·es des mêmes cercles.
Cette réalité interroge la capacité des listes « citoyennes » à échapper à ces logiques. Même avec les meilleures intentions, elles semblent reproduire les mécanismes de sélection traditionnels, qui privilégient les individus bénéficiant d’un fort capital culturel et d’une appartenance à des réseaux politiques établis.
Quelles solutions pour une meilleure représentativité politique ?
Cette situation appelle à repenser radicalement les critères de sélection des candidat·es, notamment pour les listes progressistes. Plusieurs pistes peuvent être envisagées :
Le tirage au sort, ou à minima s’astreindre à inclure davantage de candidat·es issu·es des catégories employées et ouvrières, quitte à surreprésenter ces groupes pour corriger les biais structurels actuels.
L’absence de diversité sociologique parmi les élus a des conséquences concrètes sur les politiques publiques. Par exemple, la gestion des transports à Poitiers illustre cette déconnexion, l’expérimentation des bus gratuits se fait sur le jour du marché du centre-ville, pas le jour du marché des Couronneries, ni un jour de semaine, là où il pourrait être utile aux personnes qui bossent.
Une représentation à réinventer
La surreprésentation des cadres et la faible présence des classes populaires dans le conseil municipal de Poitiers Collectif montrent que, malgré des discours de rupture, les pratiques démocratiques peinent à se renouveler. Cette situation, loin d’être propre à Poitiers, reflète un problème structurel de la vie politique française.
La question reste posée : comment renouveler la vie politique pour qu’elle devienne réellement représentative des aspirations et réalités sociales des habitants ? Poitiers Collectif a ouvert une porte, mais un véritable changement passera sans doute par des choix encore plus audacieux, tournés vers l’inclusion des classes populaires et une redistribution concrète du pouvoir. À Poitiers, comme ailleurs, les employé·es et les ouvrier·es doivent être majoritaires sur les listes dites progressistes. Sans cela, ces dernières risquent de trahir leurs propres valeurs et de perpétuer les biais structurels qu’elles prétendent combattre.
Abel R.